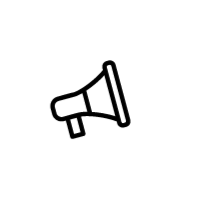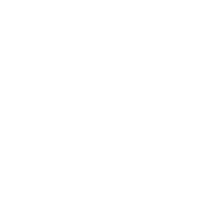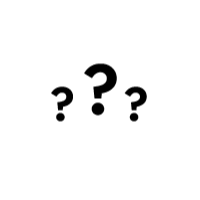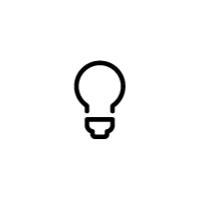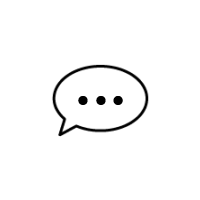À Massy, un Café IA réunit citoyens, experts, responsables publics. Chacun prend place en cercle. Une ministre, des jeunes, des professionnels : tout le monde parle à égalité. Et très vite, les peurs émergent. Ces moments d’échange montrent que la technologie ne se réduit pas à des usages techniques : elle met en jeu des émotions, des vulnérabilités, des attentes. Permettre leur expression collective est l’une des grandes forces des dispositifs d’échanges déployés dans le cadre de la démarche nationale Café IA.
Au titre des peurs individuelles, ce jour-là, c’est d’abord celle de voir ses données personnelles happées par des systèmes opaques qui s’exprime. Puis, vient celle de se sentir dépassé par des outils qu’on voudrait maîtriser mais qui semblent réservés aux autres. Ces craintes, loin d’être marginales, touchent chacun de nous. Elles rappellent que la vulnérabilité à l’égard des services numériques ne se situe pas seulement dans l’accès aux équipements ou services, mais aussi dans la confiance et la compréhension des usages. Quand la technologie suscite de l’angoisse, elle creuse l’écart au lieu de le réduire. A côté de ça, une personne dyslexique prend la parole pour parler de ses usages.
Viennent ensuite les peurs collectives. Dans le monde du travail, l’IA se faufile en catimini : on l’utilise sans le dire, de peur d’être jugé, sanctionné, voire déclassé. C’est ce qu’on appelle le Shadow AI. Avec quel résultat ? Quelques gains personnels, un peu d’aide qu’on n’aurait pas eu par ailleurs, nous le savons tous, mais aussi une forme de défiance généralisée, un jeu de dupe et un climat de dissimulation. Derrière ces pratiques invisibles peut se cacher un climat délétère menaçant à la fois le bien-être des personnes, la cohésion des équipes et la capacité des organisations à s’adapter sereinement.
Une autre crainte à mentionner est celle des dirigeants en particulier mais potentiellement de n’importe qui : celle de notre déclassement face à d’autres, qu’ils s’agissent d’entreprises ou d’États. Cette tentation de faire de l’IA un fait inéluctable auquel il faudrait s’adapter au risque de perdre la course peut s’avérer contre-productive si l’on ne prend pas d’abord la mesure des inquiétudes du quotidien, tout comme nos ambitions propres. A jouer un jeu imposé par d’autres, nous risquons de nous lancer dans une course qui finalement nous envahit déjà sans nous permettre de proposer notre projet. A trop regarder les autres pour les mimer ou nous comparer, nous risquons de nous renier en ne nous donnant pas la chance d’exprimer nos priorités. Nous manquons une chance d’être original dans tous les sens du terme : original au sens de produire des choses qui émanent de nous-mêmes, original aussi au sens de proposer quelque chose de différent, de nouveau et potentiellement de meilleur.
Ce qui n’est pas sans rejoindre ma crainte, plus intime : celle que nous finissions par déléguer à des machines le soin même de juger, d’apprécier, de critiquer et finalement d’identifier nos désirs, nos souhaits, notre volonté au sens le plus large du terme. Nous sommes beaucoup probablement à avoir reçu d’un ami d’un collègue un retour à une proposition ou à une question qui soit copié-collé d’un agent conversationnel. Peut-être l’avons-nous déjà fait avec une facilité déconcertante. Hé bien, c’est ce qui me terrifie peut-être le plus, ce cas où nous décidons ou plutôt ne décidons plus et où nous laissons notre faculté d’appréciation à la porte. Dans ce cas, il me semble que nous perdons plus qu’une compétence, un esprit critique ou une faculté d’analyse : nous renonçons à être et à mieux être, surtout collectivement.
Cette situation, comme la précédente peut trouver un écho dans la métaphore du zombie, dont une des vocations est devenue au fil du temps de représenter les personnes contaminées par la société de consommation ou la télévision, comme l’a si bien décrit l’ouvrage Z comme Zombie d’Iegor Gran dans le cas de la Russie. A la différence qu’ici la personne contaminée l’est au plus profond d’elle-même dans son appréciation d’une situation, dans son expression, dans la vocation qu’elle se donne. Et ça, comme si je me retrouvais face à un zombie finalement, ça me terrifie. Car si l’IA remplace l’attention que nous devons aux autres ou l’expression de nos ambitions, elle ne fait qu’entretenir l’indifférence et le mal-être, et par là-même une société d’objets et non de sujets.
Toutes ces peurs, quoi qu’on en pense, qu’elles soient exagérées ou avérées, il faut les écouter car ce sont elles qui disent le plus de nos usages ou non usages. Il s’agit alors non pas de se laisser guider par elles seules, mais de bâtir individuellement et collectivement des réponses. Car l’IA n’est pas qu’affaire de technologies. Elle touche au sens du travail, à notre rapport à l’expression et à l’attention que nous nous portons. Chaque peur exprimée est aussi une invitation à repenser la manière dont nous concevons nos institutions, nos métiers, nos apprentissages. Faire de nos peurs des ressources d’idées et d’alternatives, c’est peut-être là la condition d’existence d’une véritable démocratie technologique de proximité.
En tous les cas, c’est une des vocations essentielles de Café IA, la démarche nationale que nous menons depuis un an, pour faire dialoguer partout en France citoyens, élus, professionnels sur notre relation à la technologie. Un Café IA, quel que soit le format choisi parmi ceux mis en avant, c’est précisément cet espace-temps où tout peut se dire : inquiétudes, curiosités, mais aussi envies d’agir. Sa vocation est de redonner à chacun une part d’initiative, qu’il s’agisse d’expérimenter, de poser des questions, de critiquer ou d’imaginer des alternatives.
Chacun peut prendre part à la démarche, en organisant ou en rejoignant un Café IA dans sa structure, dans son quartier, dans sa communauté d’intérêt, afin que cette conversation collective s’élargisse et s’enrichisse dans tous les lieux du quotidien. Ces moments de dialogue ne sont pas des parenthèses anecdotiques : ils ont vocation à être le point de départ d’une démocratie enrichie à un moment où les technologies structurent toujours plus notre quotidien. Si nous nous privons de ces échanges, nous ne manquerons pas seulement des réponses, nous passerons à côté d’une voie démocratique, nourrie de milles questions à nous poser, au risque sinon…de nous faire zombifiés !